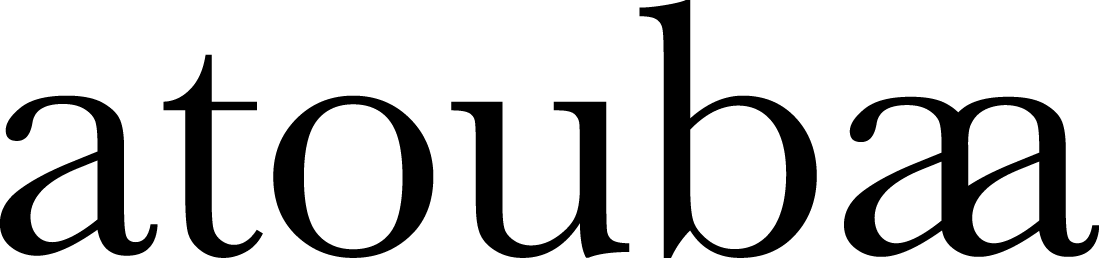Luttes croisées : entretien avec Martine Delumeau et Malaury Eloi Paisley
Image extraite de 44 jours réalisé par Martine Delumeau.
A la découverte des puissantes images d’archives exhumées par la réalisatrice Martine Delumeau pour son film 44 jours, une question nous revient : comment avons-nous pu les rater ? En janvier 2009, le LKP (Collectif contre l’exploitation outrancière) lance une grève générale et illimitée contre la vie chère en Guadeloupe. S’ensuivent plusieurs jours, quarante quatre précisément, de manifestations, de soulèvements et de négociations tendues afin de trouver des solutions à cette crise qui, nous le comprenons au fil des minutes, n’est qu’un des vestiges de l’économie coloniale de la plantation. Avec 44 jours, Martine Delumeau nous présente une évidence : il n’y a pas de lutte sans sursaut collectif, sans le peuple qui gronde et avance d’un même pas. Et pour ce même peuple, ici guadeloupéen, lutter passe par une transformation spirituelle profonde et une réappropriation de son identité culturelle. Il est également question de lutte dans L’homme Vertige de Malaury Eloi Paisley, dont la caméra se balade pendant cinq ans dans les rues désertes, entre travaux et ruines, de la ville de Pointe-à-Pitre, se faisant compagne fidèle des marginaux qui se battent silencieusement contre leurs propres fantômes. L’homme Vertige élargit la notion de peuple et nous donne une leçon sur l’importance du care en tant que praxis. Si libération il y a, elle ne se fera pas sans inclure ceux et celles qu’on fuit du regard.
A l’occasion de la sélection de 44 jours et de L’homme Vertige pour la 47e édition de Cinéma du Réel, nous nous sommes entretenues avec les deux réalisatrices pour discuter de leurs parcours respectifs, des liens entre leurs films et de l’inévitable retour.
Avez-vous vu vos films respectifs ?
Malaury Eloi Paisley : J’ai vu [44 jours] pendant le Festival du Réel. Il y avait plusieurs personnes avec moi et on en a reparlé avec ma productrice qui m'a dit qu’elle a vu un peuple. Mon amie, qui est réunionnaise, m’a aussi dit à la fin « mais quel peuple ! ». Quand la grève s’est passée, j’étais jeune mais je me souviens de tout. Je devais avoir 16-18 ans et j’habitais en Côte sous le vent à Bouillante, dans un coin assez loin des évènements. Mais on avait des membres de la famille qui étaient impactés et quand il fallait acheter les courses c’était compliqué. Donc je n’allais pas au lycée et c’était dur de trouver à manger. On a dû apprendre à manger autrement, comme dans le film de Martine. Le fait de voir ces images avec tout le recul et mon engagement artistique poétique et politique actuel, ça donne de la force. On se dit « on a été capable de faire ça ». Et puis les discours sont d’une très grande force poétique, on voit un peuple, on entend une langue, on voit une force.
Martine Delumeau : Oui absolument, et j’ai trouvé [L’homme vertige] magnifique. Le cadre et les images sont extrêmement beaux, et j’ai ressenti beaucoup d’amour pour ses personnages, ils m’ont bouleversée. Son regard, cette manière dont elle filme, je n’ai ressenti aucun jugement, mais beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion. J’aime bien l’idée de voir ces Guadeloupéens, ces personnes qui vivent à Point-à-Pitre qu’on ne voit jamais, et avec le regard de Malaury, je trouve qu’elle apporte une grande humanité, ça fait un peu bateau de le dire, mais l’humanité dans le sens le plus noble du terme.
Martine, dans votre film vous évoquez votre rapport lointain à la Guadeloupe, bien que vos parents en soient originaires, et vous dites qu’en plongeant dans les archives de la grève de 2009, il se passe quelque chose en vous comme une sorte d’inévitable retour. Et vous Malaury, vous avez grandi en Guadeloupe et vous l’avez quittée pour mieux la retrouver. Comment cette distance a affecté vos regards de cinéastes?
Martine : Je crois que la Guadeloupe n’était pas si loin de moi. Ne serait-ce que par ma mère, par le fait qu’elle accueillait toujours un cousin, une cousine, une nièce, un neveu à la maison, le temps qu’il trouve un travail. Donc elle était présente mais c’était toujours à travers le regard des autres mais pas moi qui regardais, ni me l’appropriais. Elle n’était pas absente, c’est juste une rencontre qui n’avait pas eu lieu. Ma mère me parlait en créole, et évidemment il y a des coupures dans cette culture, parce que le fait d’être interdit de parler créole est une forme de rupture dans le lien qu’on peut avoir même par personnes interposées. C’est énorme la langue ! Mais il n’empêche qu’elle n’était pas absente. Sur la fin de sa vie ma mère me parlait en créole encore plus qu’avant, elle me traduisait tout ce qu’elle me disait du créole au français et nos conversations téléphoniques duraient des heures. J’avais beau lui dire « je comprends maman » mais il fallait qu’elle traduise jusqu’au bout. Il y a un truc dans ce lien avec cette langue qui est, même si je ne la parle pas, très intime et très fort. C’est vrai que j’étais loin de la Guadeloupe mais physiquement, intellectuellement, de manière sensorielle et affective à travers ma famille, elle était présente.
Malaury : Je pense que tout est déjà en nous. Tout est déjà là. Oui, quand je suis partie, je suis restée deux ans — pas d'affilée parce que je revenais entre les deux à Paris — et ça ne s’est pas du tout bien passé pour des raisons que je ne comprenais pas. Je ne me sentais pas bien. Quand je mets les pieds sur le sol français j’ai une sensation physique de mal être, de malaise profond, comme si mon corps ne voulait pas être là. Et je vivais beaucoup de discriminations et de racisme systémique et subtil à l’université. J’étais à la Sorbonne, donc au cœur du système de valeurs et du paradigme européen et français. Mais à force de ne pas me voir dans ce qu’on m'apprenait j’ai commencé à lire autre chose. J’avais déjà lu Frantz Fanon et tout ça, et plus tôt au collège en Guadeloupe je lisais beaucoup de philosophes occidentaux, Simone de Beauvoir, Sartre, et je pense que ça m’a servi et que j’ai appris de « l’autre côté ». J’ai appris beaucoup de la Guadeloupe à travers notre absence dans les discours, et durant cette période je me suis beaucoup intéressée aux littératures autres qu’occidentales. Je suis partie à Montréal en troisième année d’étude et à la fac c’était une révolution. On avait des cours d’histoire postcoloniale, d’histoire de l’art, de sociologie, d’anthropologie, de musicologie, de théorie du cinéma, de dramaturgie. Il y avait tout, c’est-a-dire toute la crasse de l’histoire de l’occident. Je pense que ça m’a formé, que ces humiliations m’ont permis de me chercher et à Montréal je me suis trouvée parce que c’est là qu’on a commencé à évoquer Edward Saïd. Puis j’ai rencontré quelqu’un qui m’a redonné envie de lire la littérature caribéenne, j’ai commencé à lire Simone Schwarz-Bart, Maryse Condé et ensuite je suis partie en voyage en Asie du sud, en Nouvelle-Zélande et en Kanaky, et c’est là où j’ai eu vraiment un déclic, où j’ai vu le miroir. J’ai vraiment compris d’où je venais dans tous les sens du terme. Je suis un pur produit de l’histoire coloniale, j’ai l’Afrique, le sang autochtone, d’indien d’Inde et des origines lointaines européennes. Comme dit Léon Gontran Damas : « Trois fleuves coulent dans mes veines ». Durant mes voyages j’ai vu l’absurdité de la présence française parce que j’ai pu voir plusieurs types de colonisation à la fois en Asie — où c’était plus le tourisme que je pouvais aussi percevoir en Guadeloupe avec l’appropriation des terres par les expats français, et le fait qu’on n’a parfois pas accès aux plages — en Nouvelle Zélande, la version anglaise et en Nouvelle-Calédonie la version française. Je suis retournée à Montréal pour y rester quelques mois, je dépérissais littéralement et j’ai appris que j’avais une maladie liée à la contamination des terres en Guadeloupe. Je suis revenue en Guadeloupe et là j’ai vraiment compris beaucoup de choses et c’était comme si mon voile se levait. Et c’est là que j’ai fait les Ateliers Varan.
Images extraites de L'homme Vertige réalisé par Malaury Eloi Paisley.
Comment avez-vous décidé du sujet et de la forme de vos films ?
Martine : J’étais en Guadeloupe et en discutant avec une cousine à qui j’apportais un jus acheté au supermarché, un Oasis ou un Coca, des trucs que j'achèterais jamais à Paris, elle m’a dit « nous on fait nos jus nous-mêmes, 2009 est passé par là ». A partir de ce moment-là, je me suis dit que j’étais passée à côté de quelque chose et qu’il fallait que je regarde. Au départ, je regardais non seulement les archives tournées par des Guadeloupéens sur YouTube et Dailymotion mais aussi les journaux télévisés, les archives de l’INA, des images tournées par les journalistes. En voyant tout ça, je me suis dit « je suis complètement passé à côté de quelque chose ». C’est petit à petit que le rapprochement s’est fait, c'est-à-dire qu’il y a eu un rapprochement intellectuel en voyant les images tournées par les Guadeloupéens, en comprenant que cette lutte était beaucoup plus universelle qu’on ne pourrait le croire. Je suis allée plusieurs fois en Guadeloupe pour repérer les acteurs du mouvement mais aussi parler avec ma famille et d’autres personnes, dont Malaury, et un jour j’attendais ma cousine à l’aéroport qui était en retard, je me suis assise sur le trottoir et c’est là que j’ai senti physiquement, je ne saurais l’expliquer, que j’étais à ma place. Donc le rapprochement était en deux couches et c’est quelque chose que j’essaye de retranscrire dans le film.
Malaury : J’ai d’abord réalisé Chanzy Blues pour les Ateliers Varan. Chanzy Blues, partait des archives de la première rénovation urbaine, et de l’état de la ville avant la destruction de la structure sociale et du bâti tel qu’il était traditionnellement. L’après est visible dans Chanzy Blues. C’est un huit clos dans la cité Chanzy qu’on voit dans L’homme vertige, et je voulais explorer les problématiques de la solitude, de la décomposition du bâti et des corps à l’échelle de la ville. Prendre Point-à-Pitre comme une allégorie de ce qu’il se passe à grande échelle sur l’île. Pointe-à-Pitre comme un labyrinthe qui parle aussi de notre imaginaire, de notre capacité à nous en sortir mais en même temps, le fait de rester coincé dans cet état psychologique et physique qui est lié au contexte, à cette monstruosité, comme dit Patrick Chamoiseau, que sont les Outre-Mer.
Et pour la forme documentaire ?
Malaury : Je viens de Varan donc c’était clair que ce serait un documentaire, mais moi je n’ai pas cette notion de séparation. J’emploie les termes parce qu’on est dans le système français. Je préfère le terme anglais « non-fiction » parce que ça reste un peu indéfini. Mais moi tout de suite ça a été clair que je voulais m’affranchir d’une façon de faire des films. C’est pour ça que je mentionne souvent le spiralisme de l’auteur haïtien Frankétienne, parce que moi quand j’ai commencé à regarder beaucoup de films, surtout des documentaires, je me suis demandé pourquoi on n’a pas ce type d’images de nous. Toutes les images de nous sont des images de télévision ou de reportages. Et même en tant que Guadeloupéens, on s’est filmé comme d’autres nous filmeraient et c’est aussi à cause d’une façon de produire les films en Guadeloupe, principalement à cause de France TV, qui est pour moi le prolongement de l’appareil colonial, ou encore France Antilles qui est le premier journal de la colonie. On est représenté par des médias qui viennent directement de ce système donc c’est absolument impossible d’avoir un regard qui soit proche de qui nous sommes. Je n’avais pas beaucoup de références donc j’ai vu beaucoup de films africains, asiatiques, latino-américains mais pas beaucoup de films caribéens parce qu’on est coupé de la Caraïbe en étant français. On est à la fois sur une île et dans un exil géographique et culturel. Pour aller à Trinidad ou à la Barbade à partir de la Guadeloupe ça peut coûter jusqu’à 7000 euros. Il faut prendre minimum deux ou trois vols. Donc c’est l’ignorance, le manque de représentation de soi. On a beaucoup produit dans la littérature et dans notre littérature il y a vraiment une puissance esthétique, et des concepts qui n’ont pas été assez exploités et qui sont d’une grande évocation. Il y a beaucoup d’images, de métaphores, qui sont aussi à l’image de la langue créole, et le créole ce n’est pas juste une langue, c’est un état d’être au monde. Le film s’est construit avec qui j’étais aussi dans la façon de filmer : d’abord j’observe et ensuite je me rapproche et je pense que les séquences et la façon dont le film est monté raconte ce rapprochement avec les personnes, les protagonistes, avec moi-même et l’île. C’est une structure qui n’est pas linéaire et qui ne pouvait pas l’être parce qu’elle est à l’image de notre pensée rhizomique ou fragmentaire. Mais j’en ai beaucoup souffert, du fait de ne pas avoir de récit et ce jusqu’au montage. Je n’arrivais pas à comprendre comment tout ça allait faire un film. D’ailleurs, il y a beaucoup de financement qu’on n’a pas eu. J’ai eu beaucoup de retours « on ne comprend pas où est-ce qu’elle nous mène, où elle veut nous mener, qu’est-ce qu’elle veut raconter, ça part dans tous les sens, elle a trop d’ambitions » mais je pense que la qualité du projet l’a sauvé. Et surtout qu’au final ce premier film aille à la Berlinale, pour moi c’était lunaire. Mais maintenant que j’ai eu cette expérience et pour avoir vu d’autres films caribéens contemporains, je sais où est ma place et je n’ai rien à prouver ni à la France ni à l’Europe.
Images extraites de L'homme Vertige réalisé par Malaury Eloi Paisley.
Au début de votre film Malaury, un de vos sujets dit « j’aurais pu te dire de ne pas me filmer » et vous y répondez par une question « pourquoi tu as accepté que je te filme ? », il n’y répond pas directement. Mais je trouve cette question essentielle, et j’aimerais vous la retourner. Pourquoi ont-ils accepté, tout en prenant en compte la nature exploitative qu’une caméra a naturellement pour des personnes marginalisées ? et comment vous êtes-vous assurée que la dynamique entre vous ne soit jamais déséquilibrée ?
Malaury : Je pense que quand on a une caméra, il faut accepter ce malaise. Comme en étant blanc et en venant vivre en Guadeloupe, il faut accepter le malaise de ne pas être à sa place. Il y a quelque chose de cet ordre qui est très difficile, surtout en étant une femme, il y a certains milieux où tu ne te sens pas en sécurité. Peut-être qu’il y a quelque chose de la vulnérabilité de mon corps qui me met à un certain niveau ou qui me rabaisse déjà. Pour la légitimité, chaque personne nous la donne. J’ai beaucoup d’intuitions et ma façon de travailler c’est que j’habite le lieu, donc il y a des personnes que j’ai observées pendant deux ou trois ans, c’est une connaissance du corps de l’autre et qu’est ce que ce corps exprime. J’ai l'impression qu’on a hérité de ce truc de pouvoir lire les corps. C’est comme s’il y avait une histoire qui m’était racontée et le jour où j’arrive devant cette personne, il y a tellement de choses qui se passent et on se comprend tout de suite.
J’aimerais parler des liens entre vos deux films qui sont en conversation. 44 jours s’intéresse à un moment de sursaut politique collectif, à ce qu’il a créé, au sentiment d’appartenance qu’il a exacerbé - et L’homme vertige s’intéresse parfois à « l’après » vu à partir de la condition de plusieurs personnes seules dans la ville, les marges dans la marge, et qui dans une certaine mesure représente la situation presque inchangée, voire aggravée. Avez vous pensé à « l’après 2009 » en écrivant votre film ?
Martine : Ce que j’avais envie de faire avec ce film c’est qu’en le regardant aujourd’hui, on puisse mesurer la situation. Quand un de mes cousins dit « rien à changer » c’est d’un point de vue très concret, il a raison. C’est vrai que « L’homme Vertige » pourrait être une suite, vue d’un autre pan de la société. On voit un Pointe-à-Pitre un peu triste, c’est une ville comme abandonnée. C’est vrai qu’en voyant le film de Malaury, on se dit « où est la foule ? ». Il y a ce plan d’un personnage qui est malade, qui a un cancer des poumons et devant sa vitre on voit des immeubles qui sont en train d’être détruits. On se dit c’est n’importe quoi et le mot est faible.
Malaury : Je pense à « Parole de Nègre » de Sylaine Dampierre qui est exceptionnel et qui complète ce tableau. Je dirais même que c’est le premier volet de ces deux films là. Il parle de la société de plantation qui se transmet. Le film se passe dans une usine à sucre à Marie-Galante avec des ouvriers qui se réapproprient des archives du premier procès d’un maître pour le meurtre de son esclave et parle de comment ces archives disent quelque chose de la hiérarchie sociale de cette usine et de l’exploitation des corps noirs. Pour beaucoup de personnes, 2009 a changé des choses. Je me rappelle quand je suis allée à Cuba et que j’ai demandé à quelqu’un « comment a commencé la révolution ? » et le monsieur m’a ri au nez et il m’a dit « ta question me fait rire parce que tu parles de quelle révolution ? ». Il m’a dit « la révolution a commencé depuis l’arrivée des colons ». Et moi 2009, comme d’autres évènements en 2021 aussi, c’est un point culminant mais ces explosions, ces fulgurances, on est tout le temps menacé de ça, il y a tout le temps une menace, une tension, et j’ai voulu montrer cette tension dans laquelle on vit mais qui est une sorte d’inertie, de paralysie des corps qui sont dans un entre-deux. Je pense que ce film parle à beaucoup de Guadeloupéens, d’Antillais, et raconte un état du monde, cet espèce de truc entre la vie et la mort et en même temps un état de conscience très fin de la réalité, du contexte, qui ne dit pas un abandon mais qui est en soi une forme de résistance. Donc comment on résiste ? Je ne sais pas. On m’a demandé après la projection à Miami : « how do you stay sane? » Et j’ai dit « I”m not sane ». On trouve des moyens de survie mais je ne sais pas si on peut arriver à vivre ici parce que tout nous empêche de vivre. Manger c’est compliqué, ça coûte cher, c’est pas sain, c’est empoisonné, on a des maladies, on a des politiques qui ne sont pas adaptées à notre vie, à notre contexte, l’éducation non plus, on n’apprend pas notre histoire. On vit dans une société consumériste, on est envahi par l’autre, on ne peut pas accéder à la propriété. Moi même je n’ai nulle part où vivre.
Image extraite de 44 jours réalisé par Martine Delumeau.
Dans 44 jours, le Gwo-Ka représente la musique qui accompagne la lutte. Dans L’homme vertige, vous laissez la ville, souvent déserte, parler pour elle-même mais quand il y a de la musique, les instruments restent traditionnels par exemple, cette flûte qui accompagne l’un des personnages en chemin pour la grève. Comment avez-vous pensé la musique dans vos films ?
Martine : Le Gwo-Ka était la musique jouée pendant les manifestations, pendant les marches, et c’est une musique qui retranscrivait l’énergie et la puissance du collectif. Et j’ai demandé à mes cousines de composer une bande son avec leur voix uniquement, quelque chose de plus doux et de présent, parce que ça rappelle l’atténuation de la foule comme si on ne l’entendait plus. Donc c’était jouer à la fois sur ces voix féminines et douces mais quand même très présentes et cette musique qui transmet une énergie. Il fallait laisser la place à ce langage.
Malaury : Il y a plusieurs types de musicalité, je pense qu’une présence suffit, que les corps ont leur musicalité. On a aussi travaillé avec les sons du film, les démolitions, les machines, les silences qui ne sont pas des silences vides. J’ai eu deux ou trois semaines de montage son et Magic Malik est une musicien-compositeur incroyable qui cherche beaucoup et qui est imprégné de tout cet héritage des musiques traditionnelles. Lui, il a tout : la Caraïbe, l’Afrique, et il est né en Côte d’Ivoire et a grandi en Guadeloupe. Quand je pense aux choses, si c’est déjà chargé on n’a pas besoin d’entendre du Gwo-Ka pur et dur, parce que ce n’est pas juste une musique c’est une cadence. En créole on a le mot « lokans » qui est aussi le sentiment du peuple, du corps, de la musique. Et je pense que c’est présent sans qu’on est à entendre du Gwo-Ka.
La Guadeloupe comme la Martinique sont des territoires, des îles, des pays, qui se dépeuplent. Et donc le départ vers l’hexagone est une sorte d’épée de Damoclès qui pend au-dessus de la tête de beaucoup de jeunes. Martine, ce que vous faites dans une séquence de votre film c’est de montrer que l’après 2009, même s’il n’a pas marqué un « réel » progrès social, reste une avancée pour l’éducation politique de certains Guadeloupéens. Et pendant qu’il y en a qui partent, d'autres transmettent leur attachement à la terre.
Martine : C’est vrai que le territoire se dépeuple, mais j’ai l’impression que le retour se fait plus facilement pour les jeunes contrairement à la génération de ma mère par exemple qui restait [en hexagone], et le retour était moins envisagé parce qu’il y avait une forme d’attache qui s’était créée là où chacun s’était installé. Ce qui me plait dans cette séquence c’est qu’il y a quelque chose de l’ordre de l’espoir et de la transmission. C’est une séquence pour laquelle j’ai dû un peu insister et ne pas entendre les recommandations de mes productrices qui n’en voyaient pas l’intérêt. Mais moi je me disais non pas qu’il fallait terminer sur une note optimiste, mais plutôt dire que « tout » n’est pas mort. Il y a une symbolique de planter et de voir la plante croître, et dans cette symbolique je voulais dire que quelque chose s’était passée en 2009. On n’avait pas encore vu les fruits de tout ça véritablement mais on commençait à voir des feuilles, quelque chose dans la conscience et la fierté d’être soi. Il y a Fanon qui disait « Comment chanter le passé sans le faire au dépend de son présent et de son avenir ? » et je trouve que là avec les enfants, c’est une illustration. Ceux qui restent ont quelque chose à faire de cette histoire.
*Cette interview a été éditée et condensée pour plus de clarté.
L’homme vertige sera diffusé le 12 septembre prochain au Cin’Hoche de Bagnolet et le 29 septembre prochain à Paris dans le cadre du KIFF (Kreyol International Film Festival).
44 jours sera diffusé le 26 septembre prochain dans le cadre de l’Afrika Film Festival de Cologne et en octobre prochain dans le cadre du Festival International du Film documentaire Amazonie Caraïbe.