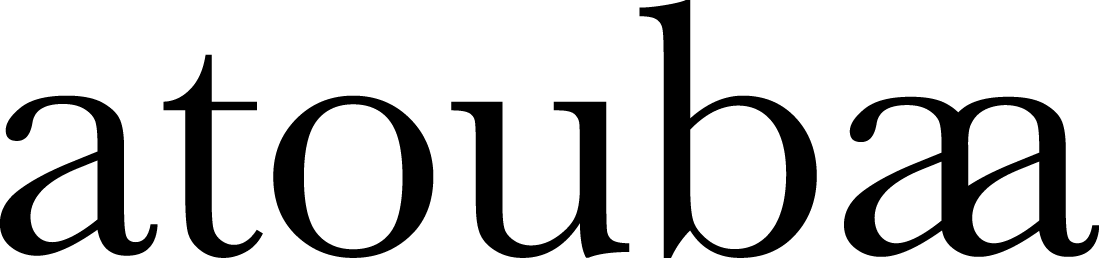Et ma langue se mit à danser
Z
J’ai toujours pensé qu’être noire c’est être gauche.
Il y a quelque part, perdue dans les trous d’une poche oubliée, cette certitude intime dont je n’ai pas réussi à me débarrasser.
J’avais oublié, presque, je crois, à quel point cette couleur me colle à la peau.
A quel point elle a pu créer mal-aise, dans ce temps de l’enfance où différence peut vite sonner comme difformité.
Quelque chose me dit que nous sommes nombreuses à renfermer cette poche. Mais tellement de difficulté à partager une langue commune avec mes Noires-Sœurs, que pas un mot n’a pu être dit sur cet intime. On se regarde et se dépasse, oublieuses de ce fil commun qui pend de nos poches.
Peut-être un jour on va s’y emmêler.
Je regardais l’autre après-midi par la fenêtre, assise dans un coin de cette rue que j’habite de tous mes regards, une femme noire, d’un certain âge, seule, dans ses pensées.
Lorsqu’elle se lève pour se mettre en marche, elle boite. Cette image, encore, me peine.
J’ai le sentiment, au fond, de la connaître depuis longtemps.
L’intuition, l’inquiétude, que ce soit ce que je suis, moi aussi : cette femme noire, un peu boiteuse.
T
Je rencontre N. un jour de mars, dans une des rues de cette ville où j’ai fini par poser mon intranquillité.
J’ai le sentiment de rencontrer mon prolongement, le pendant homme, et noir, de moi-même.
On partage ensemble cet étrange sentiment de se reconnaître.
Nos deux fragments d’humanité se réclament, et se retrouvent quelques jours plus tard pour une soirée qui ne parviendra à se terminer qu’à une heure avancée.
Moi, l’Africaine, qui a quitté si tôt ce continent que je peine à m’en sentir pleinement digne.
Lui, l’Haïtien, arrivé homme ici. Pleinement homme. Tellement homme. Entièrement pris dans son histoire avec cette terre-là.
L’un face à l’autre.
Cet Haïti, scrutant droit dans les yeux cette Afrique qui hier avait regardé partir ses enfants de l’autre coté des eaux. Leurs histoires avaient ensuite été amputées l’une de l’autre. Eux sont devenus les filles et les fils de la diaspora, avec pour tribut l’esclavage et les viols souvent institués comme mode de rencontre entre l’homme blanc et la femme noire : enfants d’un exil parfois effacé, mais bien enkysté dans les corps.
Je ne sais pourquoi, mais ce soir-là, la grande noirceur de la peau de cet homme me touche profondément. C’est le premier homme à la chair couleur charbon que j’ai envie d’approcher dans son intimité. Le sentiment de désir-menace qu’il suscite chez moi me déstabilise.
Moi et mon inavouable image sur ces hommes noirs. Moi et mon sentiment intime de leur impossible fidélité. Moi et ma certitude qu’il n’y aurait aucune place en moi pour un partage sincère avec l’un d’entre eux. Moi et mon impression jusque-là jamais formulée, que de monde intime, ils n’en avaient peut-être même pas.
Lui qui me parle de ses questionnements, de ses pérégrinations incertaines dans la vie, de son désir volatile qu’il aimerait réussir à fixer quelque part, de sa découverte des mots et d’un florilège d’écrivains qui sont devenus dernièrement ses plus chers compagnons.
Lui qui me répète l’héritage de cette négritude qui lui colle à la peau et qu’il se sent apaisé de pouvoir déposer auprès de moi, qu’il croit partager dans un commun vécu avec moi.
Moi et ma distance, réflexe pour me recouvrir, ne pas me laisser trop atteindre par lui, et qui doit filtrer quelque part dans mes gestes, puisqu’il finit par m’en tendre le miroir.
Lui, un peu stupéfait au bout de cette longue soirée, quand il comprend que j’ai grandi ici, que je ne suis pas tout à fait de là-bas, de cette Afrique à laquelle il avait désiré m’arrimer. « Je t’aurai pas parlé de tout ça, ni comme ça, si j’avais su que tu n’étais pas vraiment une exilée comme moi ».
Combien d’océans n’ont jamais été traversés, pris dans la certitude qu’une case dans l’histoire de l’autre interdisait la tentative d’une authentique rencontre ?
Lorsqu’il comprend sa méprise, quelque chose change dans le rythme de cette soirée-là. Il propose alors de se lever de ce lieu où nous étions assis depuis plusieurs heures déjà, et marcher. Certainement pour quitter ce face-à- face qui d’un coup n’avait plus la même portée. Peut-être n’arrivait-il plus à me regarder droit dans les yeux. Les masques portés jusque-là, l’Africaine, l’Haïtien, se retrouvaient caduques à cet endroit où la pointe du compas venait de nous déposer.
De ces masques effondrés, quelque chose est devenu possible. Plus vrai, probablement. Nos chemins n’avaient définitivement pas été les mêmes, l’histoire de nos migrations ne se rencontraient à aucun endroit. On pouvait alors se rencontrer vraiment dans nos deux intimités, maintenant que cette proximité factice ne tenait plus. Sans bien savoir pourquoi, à ce moment là on a abandonné ces jeux de l’amour dont on n’arrivait dorénavant plus à être dupes. Nos pas nous ont alors fait égrener pendant plusieurs heures les rues de la ville où nous croisions régulièrement des connaissances à lui, qui semblaient disséminées partout.
On a parlé de nos pères, de nos mères, les siens, les miens, aux histoires inversées, et que chacun de nous avait un peu fini par rejoindre après avoir longtemps voulu s’éloigner de leurs pas.
On a parlé de ces boites noires lovées à l’intérieur de chacun de nous, comme dans ces engins destinés au vol, et qui viennent enregistrer les informations qu’on pense pouvoir laisser derrière soi pour fonctionner, mais dont l’ouverture permet de retrouver les causes de l’ensemble des accidents du quotidien.
On a parlé de nos grands-mères, de nos grands-pères, ce qui se passait entre ces hommes-là et ces femmes-là. « Tout ce qu’ils ont pu vivre » pour lui, « tout ce qu’ils n’ont pu s’autoriser » pour moi. Leurs temps et leurs vies étaient suffisamment lointains pour qu’on n’ait pu, l’un comme l’autre, que les effleurer de quelques années. Eloignement propice pour en refabriquer les souvenirs, au gré de nos choix d’adulte qu’ils devaient venir confirmer.
On a parlé de nos féminités et de nos masculinités.
J’ai fait l’aveu de mes préjugés, gênants, sur ces hommes noirs.
Il m’a parlé de la femme, avec qui, pour lui, on ne peut plus se permettre l’allégresse joyeuse d’un désir entier et abrupt, quand elle est devenue la mère de nos enfants, la porte de notre descendance.
C’est durant cette marche qu’il pourra me raconter sa tentative actuelle pour reprendre le fil de sa relation, plus tôt interrompue, avec la mère de ses enfants.
On ne se reverra pas. Mais quelque chose dans cette soirée m’a donné le sentiment d’être pleine pour la première fois. Parce que, peut-être par méprise, peut-être par clairvoyance, cet homme avait été le premier à me regarder droit dans les yeux comme une femme pleine -et non tronquée- : pleine dans son africanité.
« Et ma Langue se mit à danser » est le premier roman d’Ysiaka Anam. Auteure à la présence mystérieuse, elle s’affirme ici comme une voix à suivre, nous faisant pénétrer dans une intimité torturée en prise avec des névroses liées à la langue, au corps et aux origines.
Et ma Langue se mit à danser, Ed. La Cheminante, 116 pages, 10€
Couverture : Fred Ebami