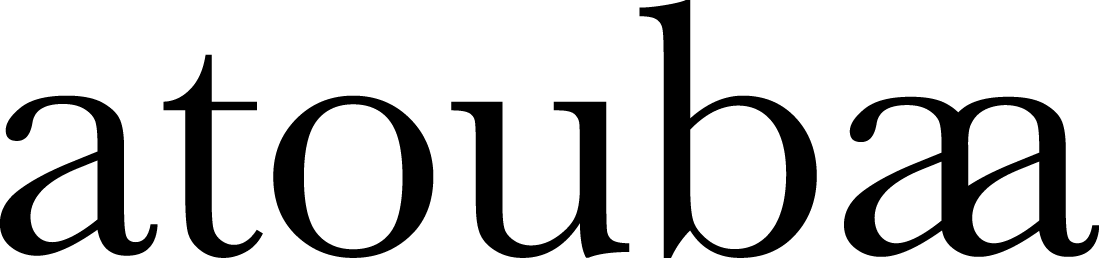Diop, Doucouré, Gay : les réalisatrices noires imposent leur regard
Ouvrir La Voix (2017), réalisé par Amandine Gay.
Il y avait urgence... Grandir sans se voir représenter à l'écran, à travers l'art ou la littérature, ou pire, se voir représenter de manière caricaturale et stéréotypée, nous conduit à nous interroger sur la valeur de notre existence et notre place au sein d'une société. Mesurant toute l'ampleur de ce problème, des femmes noires, celles qu'on ne voit et que l'on entend jamais, ont fait le choix de s'emparer de la caméra afin de nourrir leur furieux désir de représentation. Plus question d'attendre qu'on leur donne la permission ou l'occasion de s'exprimer sur des sujets choisis pour elles. Leurs oeuvres s'imposent comme des actes d'affirmation de l'existence des Noirs de France : loin d'être de simples corps mouvants, les personnages occupant l'écran sont envisagés comme de véritables vecteurs d'interrogation de la société.
Si l'inconscient collectif français éprouve quelques difficultés à envisager la réalité noire autrement que par le prisme réducteur de la comédie ou du drame misérabiliste sur fond de banlieue ou d'immigration, le premier parti pris de ces réalisatrices est de refuser catégoriquement d'alimenter et de divertir ces imaginaires hérités de l'époque coloniale. Elles constituent ainsi un cinéma à partir du matériau qu'est le réel, un réel qu'elles incarnent et dont elles sont les meilleures narratrices.
En 2015, Isabelle Boni-Claverie avait choisi d'évoquer son expérience personnelle afin d'introduire le problème de la difficile communion entre le fait d'être noire et française. Dans Trop noire pour être française, elle évoque son passé familial et son expérience de femme noire au sein de la société française. La réalisatrice pointe également les stéréotypes véhiculés par les médias et convoque différents experts, notamment des sociologues et historiens, afin de mettre des mots sur cette situation. Elle ouvre alors une porte qu'Amandine Gay décide d'enfoncer en donnant la parole et la visibilité à des femmes noires dont les expériences parlent d'elles-mêmes. Dans un entretien inédit pour Ballast, elle évoque ce qui a motivé son choix du réel pour Ouvrir La Voix : « J’ai longtemps été frustrée, dans mes travaux, de ne pouvoir écrire de la fiction sans qu’on me refuse de mettre en scène des filles noires qui n’étaient pas stéréotypées — on me faisait réécrire mes scénarios ! Puisque ce qui posait problème était qu’on ne reconnaissait pas notre existence en dehors des stéréotypes que la société blanche avait de nous, il me fallait commencer par le commencement : faire un documentaire. »
Amandine Gay se sert de la forme documentaire pour donner corps à une réalité ayant du mal à s'actualiser dans certains esprits étroits. Les intervenantes sont comédiennes, militantes, ingénieures ou étudiantes. En faisant entendre des voix singulières et des expériences différentes, la réalisatrice s'élève contre la caricature. En imposant le réel de cette manière, il s'agit de nous faire tutoyer la réalité des femmes noires aujourd'hui en France sans laisser place à la discussion. Ainsi mis face à une réalité difficile à accepter, le spectateur n'a d'autre choix que de s’y confronter.
C'est de ce même réel que Maïmouna Doucouré décide de se saisir. Dans son court-métrage Maman(s), elle interroge les effets de la polygamie au sein d’une famille jusqu’alors monogame. Française d'origine sénégalaise, elle propose à l'écran l'illustration d'une réalité lui étant familière. En nous permettant de suivre l'histoire de cette famille où les générations se mêlent, elle fait entendre la voix d'Aida, enfant de 8 ans qu'elle aurait pu être, fruit d'une équation complexe entre culture française et sénégalaise, entre modernité et tradition. Dans une interview de janvier 2015 pour le Bondy Blog, la réalisatrice dénote qu’autour d’elle la polygamie n'était pas rare et laissait plus de séquelles qu’on ne le croit : « certains de mes amis ont été détruits par la polygamie parce qu’on ne pense pas aux enfants. Jusqu’au jour où cela se ressent dans leurs résultats scolaires ou qu’ils dérapent. Il y a un réel problème de communication dans les familles ».
“Maman(s) célèbre cet amour indissoluble et non fluctuant qu’est l’amour maternel.”
Maïmouna Doucouré aborde la question de la polygamie sous un angle singulier : c'est avec un point de vue féminin qu'elle entreprend son exploration. Un formidable écho à Une si Longue Lettre, le roman de Mariama Bâ, se fait entendre ici : « Partir ? Recommencer à zéro après avoir vécu vingt-cinq ans avec un homme, après avoir mis au monde douze enfants ? Avais-je assez de force pour supporter seule le poids de cette responsabilité à la fois morale et matérielle ? Partir ! Tirer un trait net sur le passé. Tourner une page où tout n'était pas luisant sans doute mais net. Ce qui va désormais y être inscrit ne contiendra ni amour ni confiance, ni grandeur, ni espérance. » En proie au doute et à la résignation, Ramatoulaye dévoile dans ses lettres une lutte intérieure et une pleine conscience de ces injustices faites aux femmes. Avec ce récit, Mariama Bâ nous permet de dépasser l'idée reçue selon laquelle aucune protestation n'est faite contre ces traditions patriarcales. Derrière la polygamie, se cache également des mères de famille ayant fait le choix de partir afin d'élever leurs enfants seules, comme Aïssatou, la destinataire de la lettre. Sur les traces de Mariama Bâ, Maïmouna Doucouré rend donc hommage à ces femmes africaines que nous peinons parfois à comprendre et surtout à tous ces enfants touchés de plein fouet par les décisions de leurs parents. Aïda est cette petite fille qui refuse de voir sa vie bouleversée. Ressentant le besoin de réagir à la place d'une mère trop vite résignée, elle se révolte pour retrouver son équilibre familial, mais surtout pour protéger sa mère de ce tourment. En ce sens, Maman(s) célébre cet amour indissoluble et non fluctuant qu'est l'amour maternel.
Vers La Tendresse (2016), réalisé par Alice Diop.
“« Vers la tendresse » nous confronte au regard de ces spectateurs d’un monde fonctionnant sans eux. Alice Diop les fait parler et nous permet de les entendre dans toute leur singularité et leur complexité.”
De son côté, Alice Diop nous invite également à une redéfinition de ce que l'opinion commune admet comme étant une réalité. Dans Vers La Tendresse, la réalisatrice met à l'épreuve cette image que la société se fait du « jeune de banlieue » et que les médias se plaisent à relayer, une image à laquelle est associée violence et sentiment de méfiance. Partageant le même désir qu'Amandine Gay, elle met en lumière d'autres invisibles de l'espace commun, ceux dont on préfère éviter de croiser le regard. Ils sont l'incarnation parfaite de cet homme sans nom que Ralph Ellison évoque dans Homme Invisible pour qui chantes-tu ? paru en 1952 : « Je suis invisible, comprenez bien, simplement parce que les gens refusent de me voir. [...] Quand ils s'approchent de moi, les gens ne voient que mon environnement, eux-mêmes, ou des fantasmes de leur imagination – en fait, tout et n'importe quoi, sauf moi. » L'homme invisible, c'est l'homme noir dans une société américaine qui lui refuse sa place en niant son existence. Nous pourrions très aisément transposer cette oeuvre à la réalité française, dans laquelle l'identité individuelle de ces jeunes disparaît derrière leur identité sociale, leur appartenance à ce milieu qu'est la banlieue.
Vers La Tendresse nous confronte au regard de ces spectateurs d'un monde fonctionnant sans eux. Alice Diop les fait parler et nous permet de les entendre dans toute leur singularité et leur complexité. C'est une succession de voix emplies de résignation, proposant des récits de vie ponctués de longs silences, des récits crus mais hésitants : « C'est dur de parler d'amour, on connait pas l'amour en banlieue », « C'est les blancs qui connaissent l'amour [...] tu ne vois pas l'amour chez les Africains. Mon père respectait ma mère mais j'ai pas vu un couple qui s'aime, en France y'a pas le temps pour l'amour... », « J'ai compensé par autre chose. J'ai compensé par le cannabis, j'étais narco, alcoolo dépendant, tabaco dépendant, après tu t'oublies quoi, tu te construit pas dans ces cas là, tu fais semblant que t'es bien, nous on a compensé le manque d'affection avec ça... ». La réalisatrice fait le choix de donner à voir et à entendre autrement, et nous amène ainsi à interroger notre propension à nous laisser trop souvent abuser par de trompeuses apparences.
Maïmouna Doucouré, Alice Diop et Amandine Gay ne se contentent pas d’exposer plus de corps noirs à l’écran, elles en font l'expression d'un projet artistique pensé dans son ensemble. Bien plus qu'un simple moyen de transmettre un message, il faut entendre qu’il est la finalité même. Car trop souvent, les œuvres noires se voient dénier leur caractère artistique et réduites à de simples objets de contestation. Dans un entretien avec Pierre Bourdieu, Toni Morrison évoque son statut d'écrivaine afro-américaine explorant les problèmes liés à l'histoire et la condition noire aux États-Unis : « Être considérée uniquement comme témoin d’une certaine situation, ou comme quelqu’un qui n’a rien d’autre à dire que : “Aïe ! J’ai mal !” ou “Je proteste !”, est profondément humiliant, même s’il est très important que les écrivains soient considérés dans leur contexte. [...] Quelle que soit la sophistication des œuvres, quelles que soient les réponses nouvelles, les subtilités et les innovations qu’elles apportent, tout cela est absolument ignoré ; la réaction est toujours des plus banales : on y voit quelque chose de “naturel”, d’accessible, de magique ou de folklorique. » Peu importe que l’écrivain noir s’efforce de produire une oeuvre esthétiquement et techniquement complexe, elle sera réduite à un message de douleur ou de révolte avant d’être envisagée comme une œuvre littéraire. Pour rendre justice à ces oeuvres, il faudrait les resituer dans l’histoire de la littérature et leur courant comme le préconise Bourdieu. En faire de même pour le cinéma de ces réalisatrices pourrait nous permettre de mesurer la valeur de leur production, leur caractère singulier et novateur.
“Maïmouna Doucouré, Alice Diop et Amandine Gay ne se contentent pas d’exposer plus de corps noirs à l’écran, elles en font l’expression d’un projet artistique pensé dans son ensemble.”
Dans de nombreuses interviews, Amandine Gay rappelle son statut d'artiste et l'importance de l’esthétique dans Ouvrir la voix. On le ressent à la mise en scène, pensée comme un ensemble et non une simple succession de récits de femmes : « J’ai pensé à me mettre en voix off pour relier toutes ces expériences et aussi parler de la mienne. Mais en dé-rushant, ça fonctionnait de manière autonome : les filles sont claires dans ce qu’elles disent. J’ai juste laissé ma voix, à dessein, pour assumer qu’il s’agissait de conversations tout à fait orientées. Mais j’ai tenu à préciser : “Un film écrit et réalisé par Amandine Gay” car c’est un projet très écrit, en amont comme au montage. » Les partis pris d'Amandine Gay, tels la lumière naturelle éclairant les femmes qui s'expriment, ou l'absence de maquillage et de voix off, témoignent de son désir de proposer un cinéma au style épuré cher au collectif Dogme 95 de Lars Von Trier, une de ses sources d'inspiration.
Ces réalisatrices ont aussi à cœur de souligner la beauté naturelle de ces corps noirs dominant l'écran. Si dans Ouvrir la voix, ces femmes, souvent filmées en gros plan, apparaissent sans aucun travestissement, la réussite de Maman(s) tient notamment à sa mise en scène rigoureuse qui met en avant le jeu des acteurs. Aïda domine le film par sa seule présence : ses silences et ses regards lourds de sens transpercent l'écran et nous font mesurer la gravité de la situation. Le thème du corps est ainsi omniprésent dans ce court-métrage. C'est par celui-ci que la petite fille s'impose à l'écran, sa gestuelle, ses mouvements, son regard suffisent à exprimer sa force de caractère. Alice Diop, quant à elle, présente son cinéma comme un art qui utilise la puissance d'évocation des mots pour transmettre son message. Contrairement au court métrage de Maïmouna Doucouré, dans lequel les actes des personnages sont parlants et se suffisent à eux-même, ce sont les dires des personnages de Diop qui font office d'acte à part entière. En sortant du silence, en osant prendre la parole afin d'évoquer des sujets qu'ils n'abordent jamais, ils agissent pour faire évoluer la perception que l'opinion se fait des hommes qu'ils sont.
C'est tout cela qui me pousse à envisager le cinéma de ces réalisatrices noires comme un cinéma lyrique engagé. De manière si singulière, il dit la révolte à travers l'expression des sentiments et des émotions, par la mise en lumière de la subjectivité en somme. Assistons nous alors à une révolution dont ces femmes seraient les cheffes de file ? Il y aurait-il d’autres réalisateurs mettant un tel accent sur la dimension esthétique de leur film afin de diffuser leur message ?
Mamans (2015), réalisé par Maïmouna Doucouré.
Pour Jean Claude Barny, fervent ambassadeur du cinéma engagé qui aborde l’épisode controversé du BUMIDOM avec Le Gang des Antillais, c’est le cas. Visuellement réussi, avec les années 70 pour décor, le film séduit par son esthétique qui restitue l’époque avec fidélité, notamment dans le détail des costumes. Il en est autrement pour Faire l’Amour ou Les Misérables, court-métrage dénonçant les violences policières. Si Djinn Carrénard et Ladj Ly y cherchent toujours à explorer un quotidien rarement montré au cinéma, ce n’est pas par le biais d’une esthétique qu’ils vont au delà des représentations communes.
Quoiqu’il en soit, ces réalisateurs ont tous pour point commun d'oser les sujets sensibles et liés à la condition noire. Plus de dix ans après le mouvement impulsé par le Collectif Égalité au début des années 2000, ils affirment une bonne fois pour toute la complexité inhérente au fait d'être Noir en France, la nécessité d'explorer cette problématique, et l'urgence de la penser. Il était temps.
Floriane Cramer est une ancienne étudiante en philosophie et future enseignante de français, écrire lui a soudainement semblé nécessaire.