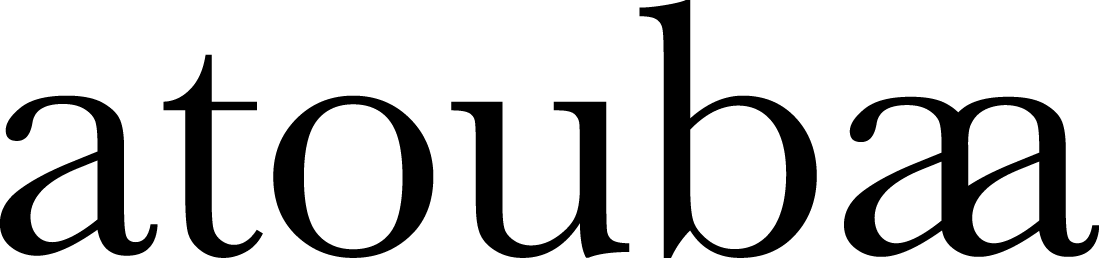Ce que «Mignonnes» dit de nous
Amy jouée par Fathia Youssouf dans Mignonnes (2020) réalisé par Maïmouna Doucouré
Cela peut paraître excessif d’exiger que le travail des femmes noires dans le cinéma français reçoive une attention particulière, ou que sa rareté octroie un caractère précieux à son existence. Pourtant, ces demandes n’ont rien d’excessif lorsqu’on connait le nombre d’années d’écart entre les sorties en salle de Rue Case Nègres d’Euzhan Palcy et de Mignonnes de Maïmouna Doucouré : trente-sept. Depuis Euzhan Palcy, il n’y a eu que deux réalisatrices noires françaises dont les longs métrages sont sortis au cinéma, Maïmouna Doucouré est la troisième. Ainsi, épiloguer sur la violente polémique provoquée par le trailer et l’affiche américaine de Mignonnes m’intéresse peu. En revanche, les réactions naturellement protectrices qu’ont eu certaines femmes noires à l’égard de la cinéaste et de son travail me disent une chose : nous sommes souvent nos premières spectatrices et nos premières critiques. Peut-être que Maïmouna Doucouré avait prédit que les personnes qui seraient les plus à même à accueillir l’histoire du personnage d’Amy la connaissait déjà un peu.
Les évènements importants se succèdent dans la vie d’Amy (Fathia Youssouf), la fille aînée d’une famille sénégalaise musulmane de trois enfants. Après un aménagement dans un nouvel appartement et son entrée en sixième, elle doit maintenant se préparer à assister au deuxième mariage de son père. Un peu par hasard, elle rencontre Angelica (Medina El Aidi) une fille de son âge qui dégage une certaine insouciance. Avec son semblant de maturité et son groupe de danse « les Mignonnes », le monde d’Angelica ouvre le champ des possibles pour Amy qui y voit une échappatoire. Mais les premiers couacs arrivent. Timide et réservée, Amy est à l’opposé de la bande d’Angelica composée de la flamboyante Yasmine (Myriam Hamma), et des deux bourrins Coumba (Esther Gohourou) et Jess (Ilanah Cami-Goursolas) qui ne cessent de se moquer d’elle. Bizarrement, les rejets ont l’effet contraire sur Amy et transforment son envie en obsession : elle veut en être quoi qu’il en coûte.
Lauréat du prix du meilleur scénario à Sundance en 2017, Mignonnes a des similitudes avec Maman(s) le court métrage multi-primé de 2015 de Maïmouna Doucouré. Les deux films traitent de polygamie en endossant le point de vue d’une jeune fille noire, très proche de sa mère. Seulement, dans Mignonnes le plan s’élargit. Alors que l’action principale de Maman(s) se déroule entre les murs d’un appartement puis d’une cité, celle de Mignonnes commence à l’intérieur de l’appartement, pour en sortir progressivement et découvrir la rue, l’école, la culture dans laquelle cette fille évolue. Très vite arrive la collision entre l’intérieur et l’extérieur puis des questions se posent : que se passe-t-il lorsque la féminité qui est célébrée à la maison est pieuse, moralisatrice et que celle qui plait à l’extérieur s’exprime de manière lascive et assumée ? Est-ce une question qu’une jeune fille de 11 ans devrait se poser ?
Maïmouna Doucouré est bien placée pour nous répondre. Née en France de parents sénégalais, elle a dû naviguer entre deux cultures. Se servant de son expérience comme piste de réflexion, elle a tenu à préciser sa réponse en discutant avec des centaines de filles pendant ses recherches. A cet âge-là, le corps des filles commence à se métamorphoser, elles ont leurs premières règles, leurs premières amours tout en devant naviguer leur environnement social. Doucouré l’a compris et le retranscrit brillamment à l’écran. Dans une des scènes les plus mémorables, Amy s’installe dans le hall de son immeuble pour observer les formes généreuses des femmes noires de sa cité, laissant apparaître sur son visage un mélange de fascination et d’envie. On comprend alors qu’onze ans est un âge de transition : ni vraiment enfants, ni vraiment adolescentes. Elles sont à cheval entre les deux. D’autres scènes le démontrent aussi bien : d’abord, elles imitent maladroitement les pas de danse des clips et la minute d’après font des crises d’angoisse à cause d’un préservatif.
Constamment seules devant des écrans, Amy et sa nouvelle bande apprennent à regarder, comparer, s’approprier leurs corps tandis que les adultes sont des ombres qui ne surgissent que pour les rappeler à l’ordre. C’est un rôle que remplit à merveille la tante d’Amy (Mbissine Thérèse Diop), dont la présence presque fantasmagorique agit comme le spectre des traditions. Les fantômes sont nombreux dans Mignonnes : cette tante, cette robe de mariage, cette porte de chambre inoccupée. Leur omniprésence apporte au film une dimension quasi mystique qui traduit de l’attachement de la réalisatrice à sa culture sénégalaise qu’elle observe toujours d’un oeil lucide.
Par moments, regarder Mignonnes s’apparente à une expérience intime. En tant que spectatrice, les silences d’Amy m’ont forcé à l’entendre autrement : par les plans serrés sur son visage anxieux et par sa respiration. J’ai passé toute la séance sur un fil, inquiète pour elle, pour sa trajectoire, pour la manière dont elle serait regardée et jugée par d’autres spectateurs et spectatrices. J’ai aussi dû me battre avec ma propre respectabilité pour ne voir que ce qu’il y avait à voir dans ses gestes : du mimétisme certes mais de l’exploration quand même. Ses moments d’apnée sont devenus les miens. J’ai retenu mon souffle avec elle, planquée sous le lit de sa mère, lorsque celle-ci annonce le deuxième mariage de son époux à sa communauté. Puis j’ai attendu patiemment, toujours avec elle, que sa mère ait une réaction à la hauteur d’une telle humiliation. Ce moment n’arrivera jamais. C’est d’ailleurs cette passivité qui m’amène à spéculer sur la source de la réponse explosive de sa fille : et si c’était au nom de celles qui ne peuvent pas réagir… Au nom du silence endolori de sa mère ?
Angelica et Amy
Au-delà de la filiation, Amy et sa mère sont liées par les limites que leur impose le système patriarcal. L’une doit accepter que les désirs de son mari polygame passent avant les siens et l’autre ne peut pas prendre possession de son corps sans qu’un regard, souvent masculin, s’immisce pour la sexualiser. Il est d’ailleurs regrettable que ce regard soit si peu indexé. « Mon film est un cri d’alarme » dit Maïmouna Doucouré, qui a eu l’idée du scénario en assistant à un spectacle « provoquant » de filles. Pour elle, il y a urgence : l’hypersexualisation de la société a des conséquences néfastes sur les filles. Les scènes de danse et les plans insistants sur ces corps à peine formés se répètent pour créer notre malaise. Ce sont les reflets de la surabondance des images et références à la sexualité dans notre société. Soit, mais qu’en est-il des regards qui se posent sur elles ? Que voient-ils ? En se focalisant uniquement sur les réactions des filles face aux images qu’elles consomment, Mignonnes ne s’attarde pas assez sur cette culture qui pense que le problème est l’existence des images et non le fait qu’on ne veuille pas les expliquer. Une culture qui menace de retirer des enfants de l’école lorsque les cours d’éducation sexuelle sont évoqués et qui se rassure en se disant, qu’à l’abri des regards, les bandes de filles chantent « Diamonds » de Rihanna en chœur alors qu’elles s’entraînent aussi, le ventre en avant les fesses en arrière, à reproduire les pas des tubes de dancehall deux notes. C’est cette culture qui est incapable de créer un espace pour que toutes les Amy puissent trouver des réponses à leurs questionnements.
En ayant cette lecture incomplète des causes de l’omniprésence du sexe, Mignonnes peine à avoir de l’empathie pour les femmes qui se sauvent elles-mêmes. Du Blues, au Hip Hop féminin en passant par le Bikutsi, l’expression orale ou physique d’une sexualité voluptueuse est utilisée par les femmes noires d’Afrique et de sa diaspora comme outil de résistance depuis des décennies. Plutôt que de vivre dans un monde patriarcal qui les assigne à être des objets de plaisir, elles privilégient le leur en expliquant, de façon crue, comment elles comptent y accéder. Les danses comme le twerk ou le whine, reprises dans le film, sont des extensions de l’expression de ces corps féminins noirs aux antipodes des normes eurocentriques. Le problème n’est donc pas tant que certaines femmes dans la marge aient modelé leur propre langage de libération et qu’il soit plus sexuel que la norme, mais qu’une fille s’empare d’un langage qui n’est pas encore le sien.
Voir une fille noire révêtir le rôle de cheffe de file des Mignonnes est un symbole fort. Selon des études, dès l’âge de 5 ans les fillettes noires sont perçues à tort comme précoces par les adultes. Le film se saisit de cette condition particulière pour en faire des pionnières, qui à travers l’exploration de leur féminité, ouvrent la voie pour d’autres filles et nous forcent à avoir des conversations honnêtes sur l’évolution de notre société. Dans une des scènes finales, la tenue de danseuse et la robe de fille modèle d’Amy sont posées sur le lit : en effet elle n’a pas à choisir, elle devrait avoir les deux. A nous de lui en donner la possibilité.
Rhoda Tchokokam a créé Atoubaa en 2016. Elle se décrit comme extrémiste du R&B et s’intéresse à la manière dont les questions de race et de genre influencent les oeuvres culturelles, notamment musicales. Membre du collectif Piment, elle a co-écrit le livre « Le Dérangeur : petit lexique en voie de décolonisation » paru en 2020 aux Editions Hors d’Atteinte.